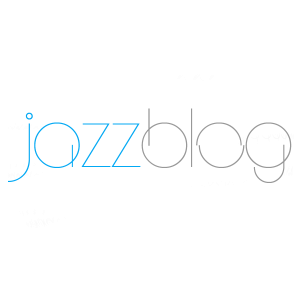Blues et jazz : quelles différences ?

On me demande souvent si le blues, c’est du jazz ou si le jazz, c’est du blues. En fait, ni l’un ni l’autre.
Le blues est le papa historique du jazz
Il est né dans un contexte pas véritablement folichon dans le sud des USA à l’époque de l’esclavage des populations afro-américaines. C’est un art vocal au tout début, intuitif, qui naît tout de même au XIXe siècle !
Il se chantait sur une pentatonique (une “gamme” à 5 notes) spéciale, une majeure 7 (septième diminuée) à laquelle les chanteurs ajoutaient spontanément une note bien spécifique, la quarte augmentée. Cette fameuse note étrange est la “blue note”. C’est ce qui donne cette patine au blues. Malgré tout, le blues est une musique tonale (qui est devenue tonimodale ensuite, c’est un peu compliqué cette histoire…) qui reste une musique spontanée, et donc une musique improvisée avec des chorus (des impros) après le thème.
Mais le blues s’est formalisé après-guerre selon une grille assez stricte, en 8, 12 ou 16 mesures (surtout 12), qui reprend un schéma de base I7 — IV7 – V7. Cependant, malgré cette formalisation classique (qui ressemble un peu à celle qu’on connaît pour écrire un sonnet !), le blues n’est pas mort ni resté enterré une fois le jazz naissant. Il a continué son chemin, toujours formalisé, mais avec un son bien différent selon ses interprètes.
Le Blues, la racine de beaucoup de genres !
Mais cette forme a inauguré beaucoup d’autres choses. Le rock est directement, historiquement, inspiré du blues dans ses premières structures en 12 mesures avec des pentatoniques blues et le schéma de base. Mais les accords ont été “simplifiés” et le rythme est devenu binaire, avec un accent sur les 2 et 4e mesures (“afterbeat”).
Pendant ce temps, le jazz a suivi son petit bonhomme de chemin. Sans aucune ambiguïté, il est un descendant direct du blues. L’histoire est un peu compliquée parce qu’elle comporte de nombreux “forks”. En gros, on peut dire que le negro spiritual donne le blues, qui va rester du blues mais aussi, parallèlement, donner naissance au ragtime (dans les bordels du sud des USA), puis le stomp, le dixie, puis le swing, puis, miracle absolu, dans les années 30 (vers 1936 de mémoire), naît le be-bop. Autrement dit, le jazz moderne.
Il faut noter qu’à la fin du swing et au début du be-bop, la frontière entre les deux est très mince. Par exemple, sans Coleman Hawkins ou Lester Young, sans Art Tatum ou Count Basie, jamais le bop ne serait né. Ils ont défriché le terrain en amenant le swing à son paroxysme, et se sont retrouvés devant la nécessité de développer autre chose. C’est à ce moment qu’une nouvelle génération est arrivée en s’appuyant sur la précédente, composée de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker, Thelonius Monk, Miles Davis, Dodo Marmarosa, Kenny Clarke, Art Blakey, Max Roach, Ron Carter, Sam Johnes et ainsi de suite…
Le be-bop, là où blues et jazz divergent…
Ici, il y a de grandes différences qui naissent par rapport au blues. On utilise encore, au début, le schéma blues (comme dans par exemple Now’s the Time de Charlie Parker). Mais on sort du tonal pour entrer dans l’univers de la musique modale. La grille blues se complexifie (typiquement I7 — IV7 — I7 — VI7b9 — IImin7 — V7b9). Ce qui ouvre d’immenses perspectives du point de vue de l’improvisation. À tel point que certains morceaux issus du blues ne sont pas facilement identifiables comme tels.
Dans la période d’avant, dans le courant swing, on improvise déjà, bien sûr, et même parfois de manière collective (plusieurs musiciens en même temps) sans que ce soit la cacophonie pour autant. Parce que tout le monde joue sur les mêmes gammes. Dans le be-bop, il y a un soliste qui est mis en avant, et qui peut s’exprimer sans limite de temps en construisant son chorus sur une grille d’accords, jouée cycliquement. Autour de lui, les autres musiciens ont une fonction rythmique et de soutien harmonique. Mais on sort totalement d’une structure entièrement écrite. Tout le monde a la même grille de base, mais le jeu s’ancre uniquement dans l’interprétation et la relecture. Donc, le morceau évolue selon les idées des solistes, il n’est jamais joué deux fois de la même manière.
La musique modale qui change tout
Comme on est ici en musique modale, le vocabulaire se complexifie et les musiciens autour du soliste (on dit en “side”) font évoluer le thème en suivant les idées du soliste en temps réel. Nous ne possédons malheureusement aujourd’hui de cette époque que des 78 tours, donc des morceaux qui ne durent pas plus de 3 minutes. Mais en vrai, sur scène, certains chorus pouvaient durer 30 minutes, certains morceaux 1 heure. Chaque soliste rivalisait d’audace et dialoguait avec les autres : c’était une nouvelle manière de concevoir et d’approcher la musique. Il y avait un aspect “performance” qui existait déjà au temps du swing, mais qui s’envolait complètement. Performance en dextérité, en imagination, mais aussi en invention.
On raconte (enfin plus précisément, Miles Davis raconte dans son autobiographie) que Charlie Parker, un soir, complètement bourré et shooté, s’est ramené au milieu d’un concert. On sait, autre fait notable, qu’en jazz, les “jam sessions” sont fondamentales : il y a sur scène un pianiste, un contrebassiste et un batteur, et tout soliste peut monter sur scène au moment de la session pour venir se frotter à ses collègues. Ce n’était pas simple et on pouvait très vite se faire jeter. Mais c’est aussi comme cela que cette musique évoluait, en confrontant les vocabulaires et les ego.
Donc, Parker titube jusqu’à la scène et tout le monde ricane : il ne tient pas debout et est habillé comme un clodo. Il commence à faire un chorus qui, au bout de 20 minutes, était devenu tellement ébouriffant, tellement nouveau, tellement puissant que les musiciens qui l’accompagnaient arrêtèrent de jouer pour l’écouter… et apprendre ! On prétend que c’est de là qu’est né le “stop chorus”, quand un soliste joue tout seul au milieu d’un morceau. Ceci n’est pas historiquement vérifié…
Quand le jazz devient une éponge
Bref, on a à cette époque revisité tous les vieux chants folkloriques des années 1900–1920, en les réécrivant de sorte qu’ils deviennent seulement des thèmes et des grilles d’accords, et en les remodelant pour pouvoir improviser dessus. On est sorti de la pentatonique blues en inventant (beaucoup) de nouveaux modes, de nouvelles notes de transition, de nouveaux rythmes. Et on a commencé à intégrer beaucoup de sources d’inspiration inédites jusque là, en allant de Stravinski à la musique afro-cubaine, en passant par les musiques brésiliennes ou Jean-Sébastien Bach. En gros, tout était bon à prendre, à intégrer puis à relire pour avancer.
La fusion des genres, ADN du jazz
Cette fusion des genres est restée inscrite dans l’ADN du jazz — ce qui n’est pas le cas pour le blues. En gros, le jazz n’a eu de cesse d’évoluer à travers ses rencontres, ses relectures, ses tentatives, pour au fur et à mesure sortir des cadres le plus possible. Sans doute comme un instrument de liberté… Jusqu’au free jazz, dans les années 50, véritable point de rupture. Entre le be-bop et le free jazz, historiquement (en 20 ans donc), il y a eu différentes “écoles” entre le “cool” et le “hard”, selon les provenances des musiciens (Côte Ouest ou Côte Est), les directions de recherche, etc. Mais en gros, c’était du be-bop qui évoluait.
Le free jazz n’était plus du tout du be-bop. L’une des figures fondamentales de la transition est, bien sûr, John Coltrane. Le free a été un douloureux moment, parfois un moment de n’importe quoi. En littérature, il est comparable au surréalisme. Ayant fait sauter tous les cadres, tout le monde pouvait tout jouer en même temps sans rythme, sans grille, sans mode. Cela devenait parfois du bruit. Miles Davis disait de Cecil Tailor qu’il ne savait pas jouer.
L’après-free : assumer toutes les musiques
Mais après cette outrance, avec l’émergence du rock (et un désintérêt affirmé du public pour le free jazz, et donc pour le jazz en général), le jazz a intégré la plus populaire des musiques pour donner naissance au jazz-rock, autrement appelé jazz fusion. Il a gardé les codes du jazz d’avant le free-jazz, s’en est approprié certains même du free, et a intégré de nouvelles lois conformes à son ADN : musique modale, improvisations, recherche, dialogues entre solistes, imagination. Il y a ajouté une approche (complexe) de la musique binaire, les rythmes asymétriques, ou la lutherie électrique puis électronique (entre autres). Et en tant que fusion culturelle assumée, c’est devenu une musique plus universelle, moins socialement récriminatrice — même si des Blancs jouaient aussi du be-bop, un peu plus tardivement, notamment en France (“Jazz Hexagonal”).
Tout cela pour quoi ? Pour rechercher le Son. Une notion un peu mystique et bizarre, comme s’il existait un son idéal à atteindre. Ce “Son”, ce “groove”, n’est pas quelque chose de simple à décrire et je ne pourrai pas trop m’y risquer. Mais le blues n’a pas nécessairement vocation à l’atteindre. Il cherche autre chose. Sans doute des racines originelles et la liberté perdue.
Le jazz, en revanche, court depuis toujours derrière cette notion où l’expression compte avant tout, beaucoup plus que la précision comme en musique classique. Je crois secrètement qu’en jazz, la recherche du Son, c’est la recherche de soi…
Du corps à l’esprit, des racines à l’idéal
Ainsi, autant le blues est une musique qui vient de l’intérieur, des entrailles, d’une douleur aussi. Autant le jazz est plus “mystique” et en même temps plus intellectuel. Il est plus théorisé car pour sortir d’un cadre, on doit parfaitement connaître ce cadre. Les deux ont bien une racine historique commune, mais pas nécessairement les mêmes objectifs. Et au vu de l’histoire de ces deux genres, il est logique que le jazz soit plus complexe à jouer ou à entendre.
Sa recherche était de sortir d’une logique de musique de danse ou de plainte, pour se placer dans de la nouveauté, de la création, de la déstructuration. Le blues était en revanche, autant que le jazz, un liant social et culturel fort pour la communauté Noire. C’est aussi en cela qu’ils ne peuvent pas être dissociés. Mais autant le blues a — et est encore — longtemps été injecté dans le jazz, autant l’inverse est moins vrai. Parce qu’un blues joué en be-bop est du be-bop, et non du blues.
Donc, pour résumer, le blues est le père de beaucoup de choses. Et le jazz est une relecture progressive, puis totale, du blues. Le blues est resté ancré dans ses origines, fièrement, tandis que le jazz est une musique fugace en éternelle transformation. Les deux ont donc leur raison d’être, mais sont bien distincts, même si des codes historiques les lieront toujours.